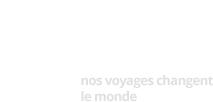-
France
-
Monde
Asie Centrale
Asie de l'Est
Asie du Sud
Asie du Sud-EstEurope -
ThématiquesEnvie de ...Vous voyagez ...
-
Le Label
-
Les labélisés
-
Témoignages
-
Définitions
-
Le mag
-
Monde

- France
- Monde
-
ThématiquesEnvie de ...Vous voyagez ...
-
Le Label
-
Les labélisés
-
Témoignages
-
Définitions
-
Le mag
Peuples autochtones : comment voyager en respectant leurs droits ?

Chaque 9 août, la Journée internationale des peuples autochtones instaurée par l’ONU est l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui, à travers le monde, protègent des cultures millénaires et des écosystèmes uniques.
C’est aussi l’occasion, en tant que professionnel.le.s du tourisme et voyageur.euse.s, de réfléchir à notre rôle : en quoi le tourisme peut-il nuire aux peuples autochtones ? Et surtout, comment le tourisme équitable peut-il devenir un véritable allié de leurs luttes ?
Qui sont les peuples autochtones, et pourquoi est-ce un sujet important ?
Contrairement au terme « indigène », souvent associé à une connotation coloniale, le mot « autochtone » désigne les populations originaires d’un territoire, porteuses de traditions, de savoirs et de modes de vie ancrés dans leurs terres ancestrales.
Les peuples autochtones représentent environ 476 millions de personnes réparties dans plus de 90 pays. Selon l’ONU, bien qu’ils ne constituent que 6 % de la population mondiale, ils protègent 80 % de la biodiversité de la planète. Ce sont les gardiens de plus de 5 000 cultures distinctes et d’une immense diversité linguistique, puisque la grande majorité des 7 000 langues vivantes sont parlées par des peuples autochtones.
Les peuples autochtones font partie des populations les plus marginalisées : ils subissent discriminations, spoliations, violences… Leurs droits, et notamment celui de continuer à vivre sur les terres de leurs ancêtres, continuent d’être bafoués.
Tourisme et peuples autochtones : quelles dérives ?
Le tourisme peut se transformer en outil d’oppression. Folklorisation, expulsions, spoliation culturelle et économique : dans bien des cas, les peuples autochtones ne sont pas les bénéficiaires du tourisme, mais ses premières victimes.
Voici quelques témoignages recueillis par l’ONG Survival International, qui lutte pour les droits des peuples autochtones :
« Ils nous ont expulsés sous prétexte que notre présence nuisait à la forêt. Aujourd’hui, il y a des jeeps de touristes qui circulent sans cesse. Ne sont-elles pas plus dérangeantes pour les animaux que nous ? » – Témoignage d’un membre du peuple Jenu Kuruba, Inde
« Regardez les brochures touristiques : vous y verrez des paysages africains sublimes, mais vides. Aucun village, aucun être humain, ni de bétail. Parfois, les habitants sont même effacés par Photoshop. » – Mordecai Ogada, expert kényan de la conservation
« L’idée de « nature sauvage » est un mythe colonial. Ces terres que l’on prétend vides sont en réalité les lieux de vie de communautés entières. » – Fiore Longo, Survival International
Ces dérives ne sont pas marginales. Elles sont liées à une vision du monde où la nature serait à préserver… sans les humains qui y vivent depuis des générations. C’est ce que Survival International appelle la « fortress conservation » : créer des parcs naturels en excluant les habitants qui les ont toujours protégés et ont su en exploiter durablement les ressources.
Quels bons réflexes à adopter pour voyager sans nuire aux peuples autochtones ?
De plus en plus de voyageur.euse.s souhaitent visiter des destinations dans lesquelles vivent des minorités ethniques. La raison principale : leur exotisme et de leur formidable richesse naturelle et culturelle. Les modes de vie alternatifs des peuples autochtones représentent un attrait pour de nombreux touristes cherchant des expériences authentiques, loin d’une mondialisation homogénéisante.
Avant de visiter un territoire habité par un peuple autochtone, il est essentiel de s’informer et de faire preuve de discernement pour éviter de perpétuer, malgré soi, le racisme et le colonialisme.
L’ONG Survival International propose quelques conseils précieux :
À faire :
- S’informer sur les enjeux locaux dans les zones naturelles protégées. Il faut être conscient que de nombreuses destinations ont été vidées des populations qui géraient historiquement ces territoires et ont permis la préservation de la faune que l’on y observe aujourd’hui.
- Choisir des voyagistes qui travaillent directement avec les communautés autochtones, dans le respect de leur autonomie et avec une juste répartition des revenus.
- Respecter les cultures, les traditions, les personnes. Être humble, observer, écouter.
À éviter :
- Soutenir des ONG environnementales qui participent à l’expulsion des peuples autochtones, comme cela a été documenté avec certaines actions du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et de la Wild life Conservation Society.
- Visiter des lieux d’où les peuples autochtones ont été chassés pour laisser place au tourisme.
- Prendre des photos ou vidéos sans le consentement des personnes.
Le tourisme équitable, un allié des peuples autochtones
Dans de nombreuses destinations, des communautés autochtones s’organisent pour mener projets de tourisme communautaire. Les habitants décident donc de l’accueil, de l’organisation, des activités proposées. Le voyage devient un levier de développement local, un complément de revenu qui ne remplace pas les activités traditionnelles, mais les soutient.
Le tourisme communautaire peut également permettre aux communautés autochtones de valoriser les savoir-faire, les langues, les récits, les modes de vie. C’est un outil d’autodétermination. Ainsi, les peuples autochtones choisissent comment ils veulent être représentés, avec qui ils veulent travailler, et dans quelles conditions.
Les voyagistes porteurs du Label Tourisme Equitable s’engagent pour être des alliés des projets touristiques portés par les communautés autochtones. Ils défendent un tourisme respectueux, émancipateur, et qui défend les droits de personnes. Le tourisme équitable est basé sur la co-construction des séjours avec les communautés, la juste rémunération, et la valorisation des cultures locales.
Enfin, le tourisme équitable peut jouer un rôle politique. En mettant en lumière les luttes locales des peuples autochtones (accaparement des terres, discriminations, menaces environnementales), il contribue à leur donner une visibilité internationale.
Cet engagement dépasse le champ du tourisme. D’autres organisations du commerce équitable soutiennent également les peuples autochtones. C’est le cas, par exemple :
- Du label Symbole des Producteurs Paysans (SPP), porté par des organisations de producteurs. Celui-ci promeut les droits fonciers et l’autonomie des communautés.
- De Guayapi, entreprise engagée dans la valorisation des savoirs autochtones à travers des filières équitables de plantes d’Amazonie. Elle est en partenariat avec des peuples comme les Sateré Mawé.
Ces modèles montrent qu’il est possible de consommer, voyager, s’émerveiller sans exploiter. Et que le respect des peuples autochtones va de pair avec la préservation de la planète.
> Bien choisir son séjour écotouristique : évitez les pièges en optant pour le tourisme équitable !
Un tourisme qui respecte et soutient les personnes autochtones, c’est possible !
Les peuples autochtones ne sont pas des vestiges du passé. Ils sont des acteurs vivants de la diversité culturelle et écologique mondiale et leurs droits doivent être protégés.
En tant que voyageur.euse.s, nous avons un rôle à jouer. Choisir le tourisme équitable, c’est faire le choix de rencontrer l’autre dans le respect et de contribuer à préserver des modes de vies singuliers.
Autres actualités



-
Le tourisme équitable et solidaire
- Voyager autrement en famille
- Définition du tourisme équitable
-
Informations légales


 aventures insolites
aventures insolites  culture et découverte
culture et découverte  nature et grands espaces
nature et grands espaces  treks et randos
treks et randos  voyage en immersion
voyage en immersion  avec des enfants
avec des enfants  en collectivité ou CE
en collectivité ou CE  en groupe
en groupe  en solo
en solo