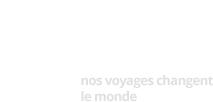-
France
-
Monde
Asie Centrale
Asie de l'Est
Asie du Sud
Asie du Sud-EstEurope -
ThématiquesEnvie de ...Vous voyagez ...
-
Le Label
-
Les labélisés
-
Témoignages
-
Définitions
-
Le mag
-
Monde

- France
- Monde
-
ThématiquesEnvie de ...Vous voyagez ...
-
Le Label
-
Les labélisés
-
Témoignages
-
Définitions
-
Le mag
Sobriété, hospitalité et savoir-faire locaux : ce que les labels de tourisme oublient trop souvent

Pourtant, bien avant que ce terme ne soit popularisé, des communautés locales en France et à l’international vivaient déjà selon les principes que nous appelons aujourd’hui « tourisme durable » ou « faible impact ».
- Elles cultivaient en respectant les saisons.
- Elles construisaient avec les ressources disponibles sur leur territoire.
- Elles partageaient, réparaient, réutilisaient, échangeaient.
Ces pratiques n’étaient pas théorisées. Elles faisaient plutôt partie d’un mode de vie, transmis de génération en génération.
Quand la durabilité s’uniformise
Le paradoxe est qu’aujourd’hui, la plupart des modèles dominants de durabilité et de labélisation sont pensés en Europe ou en Amérique du Nord, puis imposés ailleurs. Résultat, cela cause :
- des cadres rigides qui ne tiennent pas compte des réalités locales,
- des certifications coûteuses auxquelles les petites structures n’ont pas accès,
- des audits numériques exigeant Internet, anglais et outils technologiques, souvent inadaptés.
Ainsi, des communautés qui vivent durablement depuis toujours se retrouvent marginalisées ou jugées « non-conformes ».
À titre d’exemple, une chambre d’hôte sobre, où rien n’est gaspillé, ne figurera pas parmi les écolodges « certifiés ». A contrario, une maison traditionnelle en bois ou en terre, conçue pour laisser circuler l’air, sera jugée « archaïque », tandis qu’un écolodge climatisé alimenté par panneaux solaires obtiendra un label « vert ».
Est-ce vraiment cela, la durabilité ? Ou est-ce simplement une nouvelle forme d’effacement des savoirs locaux ?
Redonner leur place aux savoirs locaux
Si l’on veut construire un tourisme durable, basé sur la sobriété, l’hospitalité et l’authenticité des rencontres, il est temps de changer de regard. Cela passe par trois évolutions essentielles :
- Décentrer la vision occidentale pour reconnaître la pluralité des savoirs et des pratiques.
- Faire confiance aux expériences vécues, plutôt qu’aux seules check-lists de conformité.
- Adapter les critères d’évaluation au contexte, en posant la question : Quelles sont vos valeurs, et comment s’ancrent-elles dans votre territoire ?
Car la durabilité n’est pas la recherche de perfection. Elle repose sur trois valeurs fondamentales : la responsabilité, la résilience, et la réciprocité. Il s’agit de valeurs universelles, mais que de nombreuses communautés pratiquent sans en faire un slogan marketing.
Faut-il abandonner les labels de tourisme ?
Face à ces paradoxes, une question se pose : faut-il jeter les labels à la poubelle ?
La réponse est non.
D’un côté, certains acteurs affirment : « Moi, je n’ai pas besoin d’un label, j’agis«
Ils ont parfois raison, dans la mesure où de nombreux labels de tourisme ne sont que des listes d’indicateurs de conformité. Ces mêmes indicateurs sont souvent vides de sens dès lors que l’on travaille avec des organisations de tourisme communautaire, autochtones, ou que l’on pratique le tourisme chez l’habitant-e, faisant la part belle à la rencontre avec des actrices et acteurs de la vie locale, non-professionnel.le.s du tourisme. Mais ce discours peut aussi masquer des pratiques opaques, et éviter toute remise en question. Dans ce sens, les labels indépendants restent essentiels pour garantir la sincérité et la crédibilité des engagements.
Les labels de tourisme doivent évoluer. Pour rester pertinents, ils doivent :
- intégrer des critères qualitatifs, en lien avec les pratiques réelles de terrain,
- inclure des enquêtes locales, auprès des partenaires et communautés concernées,
- reconnaître et valoriser les savoir-faire traditionnels comme leviers de durabilité.
L’exemple du Label Tourisme Équitable
C’est dans cette optique que l’ATES (Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire) a conçu le Label Tourisme Équitable.
Contrairement aux modèles dominants, ce label a été pensé pour :
- mettre en avant la manière dont les voyagistes garantissent une place de choix aux prestataires les plus vulnérables,
- valoriser la diversité des pratiques locales, plutôt que de les normaliser,
- S’assurer que les pratiques sont équitables, mais que l’évaluation de ces pratiques l’est aussi !
Le tourisme équitable et solidaire repose sur un principe simple mais fondamental : mettre la dignité et les savoirs locaux au centre. Reconnaître la valeur de chaque culture. Marcher ensemble vers des modèles de voyage réellement durables, qui ne se contentent pas de cocher des cases mais qui respectent les territoires et celles et ceux qui y vivent.
Vers un nouveau langage de la durabilité
En définitive, la question n’est pas de choisir entre labels ou pratiques locales. L’enjeu est de bâtir un nouveau langage de la durabilité :
- un langage qui s’inspire des sagesses anciennes au lieu de les effacer,
- un langage qui intègre les labels, mais de manière plus souple et inclusive,
- un langage qui redonne la durabilité aux personnes qui l’ont pratiquée bien avant que celle-ci ne devienne un marché.
Parce qu’au fond, la durabilité, ce n’est pas seulement une affaire de certifications ou de communication. C’est une manière de penser la relation entre les humains, la nature et l’hospitalité. Une relation que de nombreuses communautés ont préservée, et que le tourisme responsable doit désormais apprendre à écouter et à valoriser.
En conclusion
Les labels de tourisme durable sont utiles, mais insuffisants s’ils continuent d’imposer une vision uniformisée et déconnectée des réalités locales. Pour un tourisme vraiment durable, sobre et hospitalier, il est urgent de reconnaître les pratiques des communautés et les savoirs locaux qui incarnent depuis toujours la responsabilité, la résilience et la réciprocité.
Redonnons la durabilité à celles et ceux qui en sont les véritables gardiens !
Autres actualités



-
Le tourisme équitable et solidaire
- Voyager autrement en famille
- Définition du tourisme équitable
-
Informations légales


 aventures insolites
aventures insolites  culture et découverte
culture et découverte  nature et grands espaces
nature et grands espaces  treks et randos
treks et randos  voyage en immersion
voyage en immersion  avec des enfants
avec des enfants  en collectivité ou CE
en collectivité ou CE  en groupe
en groupe  en solo
en solo